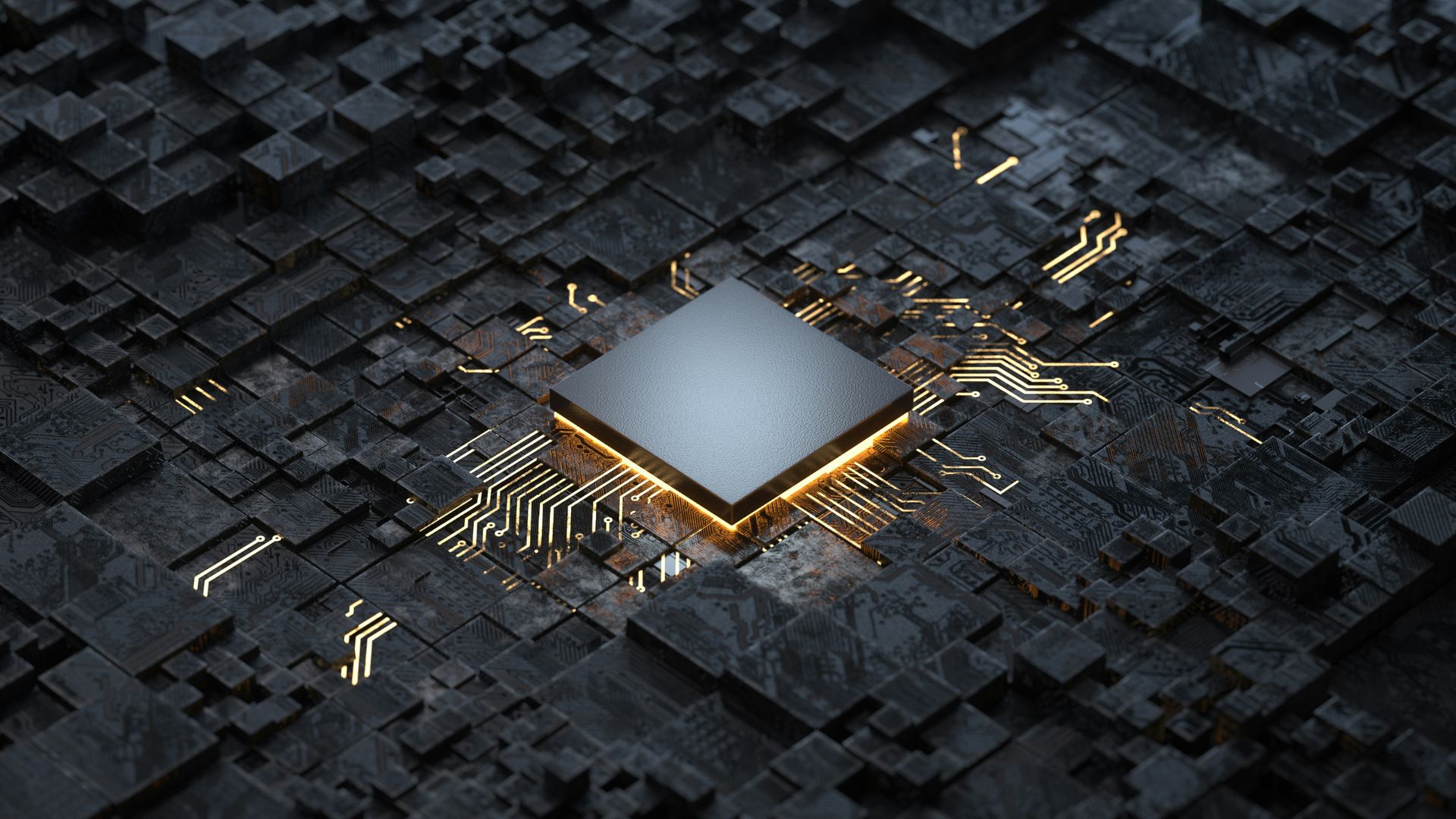Actualités
La division locale de Hambourg de la JUB fournit des orientations sur la mesure dans laquelle un brevet peut être utilisé comme son propre « lexique »
juin 2025
Agfa NV c. Gucci & Autres. [UPC_CFI_278/2023] – Division locale de Hambourg de la JUB (Klepsch, Schilling, Sarlin) – 30 avril 2025
Alors que nous attendons une décision sur G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’OEB concernant l’interprétation des revendications, la division locale de Hambourg de la JUB a fourni des orientations sur la mesure dans laquelle un brevet peut être utilisé comme son propre « lexique ». En contraste apparent avec la décision de la Chambre de recours technique de l’OEB dans l’affaire T56/21 selon laquelle il n’y avait pas de base juridique pour adapter la description aux revendications accordées, la division locale a estimé qu’il y avait plusieurs passages dans la description du brevet en litige qui « auraient dû être supprimés » à la lumière des modifications apportées au brevet pendant l’examen. La division locale a jugé que ces parties de la description étaient incompatibles avec les revendications accordées et, par conséquent, ne pouvaient pas servir de base à une interprétation large des revendications.
Contexte
Cette affaire concernait le brevet d’Agfa pour la fabrication de cuir naturel décoré et d’articles en cuir par impression à jet d’encre. La méthode brevetée impliquait l’application d’une couche de base contenant un pigment pour fournir une « couleur achromatique » au cuir, puis l’impression à jet d’encre d’une image en couleur sur la couche de base. Agfa a poursuivi Gucci, tandis que Gucci a demandé reconventionnellement la révocation du brevet.
Le litige portait sur l’interprétation de la signification du terme « couleur achromatique ». La revendication indépendante du brevet
Le jugement
Comme c’est maintenant la pratique établie de la JUB, la division locale de Hambourg a souligné que les termes utilisés dans les revendications régissaient l’interprétation des revendications[2]. Ils n’étaient pas seulement le « point de départ » pour l’interprétation des revendications, mais la base faisant autorité pour déterminer l’étendue de la protection. Néanmoins, la description et les dessins devaient toujours être pris en compte, même lors de l’interprétation de termes apparemment clairs. Par conséquent, conformément à l’approche de la Cour d’appel de la JUB dans l’affaire Nanostring c. 10x Genomics [UPC_CoA_335/2023], la division locale a confirmé qu’un brevet pouvait être utilisé comme son « propre lexique ».
Dans le cas présent, la division locale a interprété la « couleur achromatique » à la lumière du paragraphe [0021], qui contenait une définition de la couche de base achromatique. Ce passage indiquait qu’une couleur chromatique était toute couleur dans laquelle une longueur d’onde particulière prédominait. Le bleu et le vert étaient donnés comme exemples de couleurs chromatiques, tandis que le blanc, le gris et le noir étaient donnés comme exemples de couleurs achromatiques. Ces dernières couleurs étaient décrites comme n’ayant pas de teinte dominante, ce qui signifie que toutes les longueurs d’onde étaient présentes en quantités approximativement égales dans ces couleurs.
Les arguments pour la contrefaçon et la validité portaient sur la question de savoir si l’ivoire pouvait être considéré comme une « couleur achromatique ». Appliquant la définition du paragraphe [0021] selon laquelle toutes les longueurs d’onde devaient être présentes en quantités approximativement égales, la division locale n’a pas considéré qu’une couche de base ivoire était « achromatique » au sens de la revendication car l’exigence de longueur d’onde n’était pas satisfaite. En arrivant à cette conclusion, la division locale a estimé que, bien que le brevet considère par exemple le blanc et le gris comme des couleurs achromatiques, il était clair pour une personne du métier que tous les tons de blanc et de gris ne répondaient pas à la définition d’achromatique du brevet, car certains tons de blanc ou de gris n’auraient pas toutes les longueurs d’onde présentes en quantités approximativement égales.
L’interprétation de la « couleur achromatique » par la division locale a pu être décevante pour Agfa car des parties de la description de son brevet décrivaient des couches de base ayant des couleurs blanc cassé, argile pâle et jaune pâle. Notamment, le paragraphe [0029] du brevet mentionnait « une couche de base contenant un pigment blanc et un ou plusieurs pigments de couleur pour fournir par exemple une couleur blanc cassé ou argile pâle ». De même, l’exemple 3 décrivait la couche de base comme ayant une « couleur jaune pâle (couleur argile) ».
De l’avis de la division locale, cependant, ces parties du texte ne soutenaient pas l’affirmation d’Agfa selon laquelle toutes les couches de base blanc cassé entraient dans le champ d’application de la revendication, car la demande telle que déposée initialement concernait à la fois les couleurs chromatiques et achromatiques. La référence à la couleur chromatique a toutefois été supprimée au cours de l’examen de la demande. Par conséquent, la division locale a considéré que les modes de réalisation « blanc cassé », « argile pâle » et « jaune pâle » ne relevaient plus du champ d’application de la revendication 1 telle que modifiée, car ils n’avaient pas de longueurs d’onde présentes en quantités approximativement égales. Ainsi, la division locale a simplement considéré les modes de réalisation « blanc cassé », « argile pâle » et « jaune pâle » comme des incohérences avec les revendications accordées qui « auraient dû être supprimées ». Leur inclusion dans la description ne pouvait pas l’emporter sur la définition claire donnée au paragraphe [0021] en raison de la nécessité de sécurité juridique.
Conclusion
Cette affaire met en évidence le risque d’inclure des définitions étroites des termes dans les brevets. Même si un brevet contient des exemples qui soutiennent apparemment une interprétation plus large d’une revendication, les titulaires de brevets peuvent ne pas être en mesure de s’appuyer sur ces exemples pour justifier une interprétation large de la revendication si un terme est défini plus étroitement ailleurs dans le texte. Bien que la division locale dans cette affaire se soit efforcée d’expliquer que l’historique de la procédure n’était pas pris en compte dans tous les aspects, elle a néanmoins pris note de la manière dont les revendications avaient été modifiées pendant l’examen. Cela a influencé sa conclusion selon laquelle les exemples plus larges étaient des incohérences qui « auraient dû être supprimées » lors de l’adaptation de la description aux revendications autorisées.
En attendant la décision de la Grande Chambre sur G1/24, il reste à voir quelle approche l’OEB adoptera pour interpréter les revendications. Bien que la Grande Chambre ait indiqué qu’elle apporterait plus de clarté sur le rôle de la description dans l’interprétation des revendications, il n’est pas encore clair si la Grande Chambre abordera également la question de l’adaptation de la description. Cette dernière n’était pas une question formellement posée dans G1/24. Cependant, le Président de l’OEB a considéré que la question de savoir si l’adaptation de la description était obligatoire était importante pour déterminer si les revendications devaient être interprétées à la lumière de la description
[1] EP3388490
[2] conformément à l’article 69 CBE et à son protocole
[3] Voir le paragraphe 87 des observations du Président du 7 novembre 2024 sur G1/24
Cet article a été rédigé par Hsu Min Chung, Associé et Mandataire en Brevets