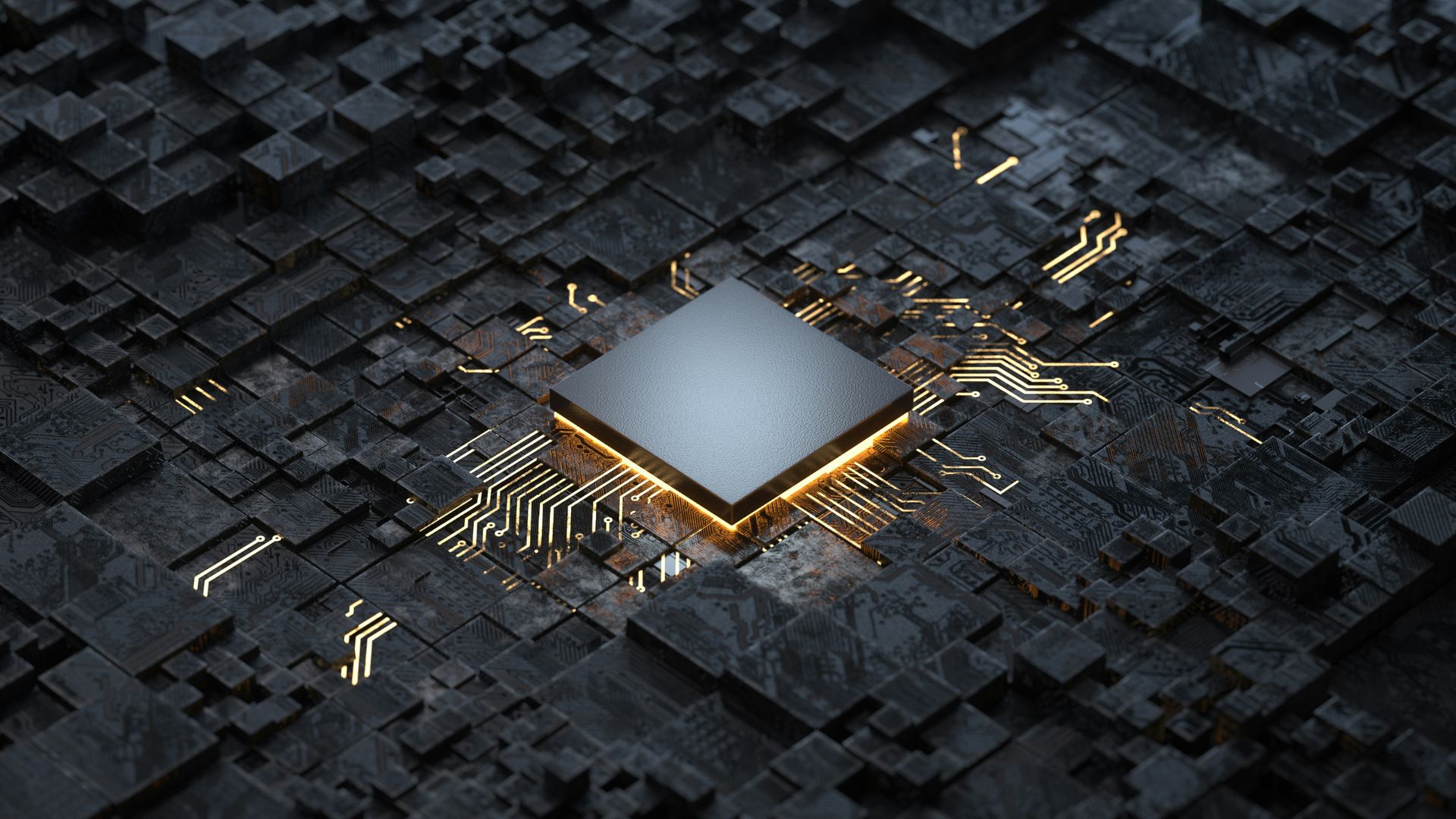Retail Scanner
Le surcyclage des produits et les propriétaires de marques
avril 2021
Le surcyclage est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, l’augmentation de la sensibilisation environnementale tant chez les entreprises que chez les consommateurs stimulant cette tendance, mais cela s’accompagne de nouveaux défis pour les propriétaires de marques.
Le surcyclage est un concept particulièrement unique du point de vue des marques. Nous avons déjà vu des cas, comme lorsque Rolex a poursuivi Vintage Watchmaker LLC aux États-Unis pour avoir proposé des pièces détachées non approuvées par Rolex, affirmant que cela constituait de la contrefaçon, mais le surcyclage est quelque peu distinct. Le produit d’origine a été repris et réutilisé, retravaillé, réemployé ou même réimaginé, mais s’il porte toujours la marque du propriétaire, il est compréhensible que cela puisse attirer l’attention de ce dernier.
Il serait difficile de considérer le surcyclage comme fournissant des produits contrefaits de la même manière que Rolex a argumenté que l’utilisation de pièces non approuvées rendrait la montre contrefaite. Cependant, on peut soutenir qu’en pratiquant le surcyclage, le « surcycleur » enfreint la marque, dilue la marque, se livre à une concurrence déloyale, cause des dommages à la réputation et crée de la confusion. Des allégations audacieuses, certes, mais qui ont toutes été avancées récemment dans une affaire intentée par Chanel contre Shiver and Duke LLC aux États-Unis, qui produisait des bijoux à partir de boutons Chanel authentiques arborant leur monogramme « C » entrelacé, dans un cas où le propriétaire de la marque a sans doute une revendication d’infraction plus justifiable.
Le principal problème pour les propriétaires de marques dans les cas de surcyclage est le principe d’épuisement au Royaume-Uni et dans l’UE, ou la doctrine de la première vente aux États-Unis, qui établit dans sa forme la plus simple qu’une fois qu’un propriétaire de marque met ses produits sur le marché, il ne peut empêcher leur revente ultérieure. Cependant, dans des cas comme celui de Chanel, on entre dans une zone grise : un produit authentique a été vendu, les droits sont donc épuisés pour ce produit, mais peut-on alors contrôler ce qui est fait avec ces pièces, comment ces pièces retravaillées sont vendues et les références utilisées pour le faire.
Il y a peut-être deux faces à cette médaille et les entreprises sont dans une position délicate, particulièrement sous l’œil du public et des médias. En théorie, nous devrions encourager la réutilisation et les moyens de réduire le gaspillage, mais d’un autre côté, s’il y a place à la confusion et que les consommateurs peuvent croire que les produits sont les vôtres, cela n’est clairement pas souhaitable si d’autres peuvent profiter de votre réputation, d’autant plus que le contrôle sur la qualité et le service client est perdu. Il est donc compréhensible de voir des cas comme celui intenté par Chanel dans ce cas. Les propriétaires de marques doivent également être prudents car beaucoup des « surcycleurs » les plus enthousiastes, du moins à petite échelle, sont les fans les plus ardents de la marque.
Le contexte de cette affaire Chanel est qu’en réponse à la production par Shiver and Duke d’articles de bijouterie fantaisie comportant les boutons monogrammés « C » de Chanel, Chanel a d’abord envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Shiver and Duke, à laquelle Shiver and Duke a simplement répondu en ajoutant la mention « retravaillé, réimaginé, design original de Shiver and Duke » aux produits, tout en continuant d’indiquer qu’ils étaient fabriqués à partir de boutons Chanel authentiques. Ils ont également ajouté « SD SHIVER + DUKE » au dos des boutons. Bien que certains aspects de cette réponse puissent être satisfaisants, comme le fait de préciser qu’il s’agit de designs originaux de Shiver and Duke, l’ajout de l’inscription sur le bouton peut créer plus de confusion. Cette affaire n’a pas encore été tranchée et concerne les États-Unis, mais elle met en lumière un profil factuel important à connaître.
Il faut examiner la question du surcyclage tant du point de vue purement juridique que du point de vue pratique de la réputation associée à toute action d’application envisagée. Une évaluation raisonnable de la validité de la réclamation d’un propriétaire de marque peut être trouvée dans la réponse à la question : quel est le nouveau produit ? Est-il différent du produit vendu par le propriétaire de la marque ? Si la réponse est oui, alors le propriétaire de la marque devrait avoir une base raisonnable pour une réclamation. Dans l’affaire Chanel, le produit en vente n’est plus un bouton, mais un bijou dont Chanel n’a pas consenti à la vente. Concernant l’affaire Rolex, le produit en vente reste sans doute une montre. De plus, la marque du propriétaire est-elle utilisée dans un sens de marque pour vendre le nouveau produit concerné ou simplement dans un sens descriptif pour « décrire » ce qui compose le produit ? Dans le premier cas, la marque devrait avoir une base raisonnable pour la réclamation, dans le second cas, moins. Enfin, indépendamment de la force juridique de la position du propriétaire de la marque, le surcyclage soulève des questions spécifiques en matière d’application. De nombreux surcycleurs à petite échelle sont des fans de la marque et adopter une position trop agressive dans ces cas pourrait entraîner un « retour de bâton » réputationnel. Si ces contrefacteurs sont des fans de la marque à petite échelle, une politique éducative est peut-être préférable à une politique d’application. Cependant, lorsque les ventes atteignent un niveau commercial susceptible de causer des dommages à la marque, l’application peut être la seule option.
À l’ère de la sensibilisation environnementale et, de manière assez opportune, à l’ère du coronavirus où pendant le confinement, beaucoup se sont mis à leur table de cuisine pour devenir créatifs et même générer des revenus supplémentaires, le surcyclage ne fera qu’augmenter en prévalence, et une approche consciente et évolutive devra être envisagée par les propriétaires de marques.
Cet article a été préparé par Suzan Ure, Conseil en Marques chez HGF.